- Accueil
- Philosophie
- Livres de MNL
- La leçon de philosophie IV
La leçon de philosophie IV
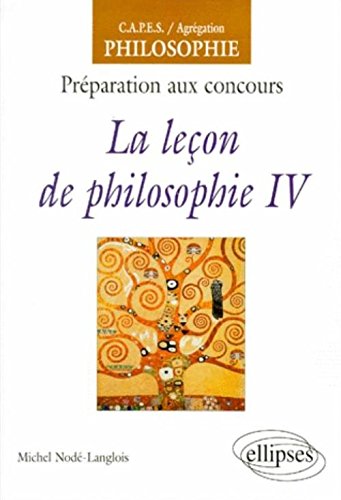
2000 - 253 p - indisponible
![]() La lecon de philosophie iv (1.73 Mo)
La lecon de philosophie iv (1.73 Mo)
Préface
Ce livre voulait être un hommage autant qu’un outil. Michel Gourinat s’y est peut-être trouvé imité jusqu’au pastiche, puisque les textes ici proposés ont été conçus en application de la méthode qu’il inculquait aux khâgneux marseillais à la fin des années soixante du dernier siècle, et dont il a magistralement exposé les principes et les règles dans son Guide pour la Dissertation et le Commentaire composé en philosophie (Hachette, 1977), ouvrage malheureusement non réédité et qui aurait dû s’intituler De la Dialectique, pour se présenter comme le pendant et le complément, parfois l’approfondissement voire la rectification critique, du fameux manuel De la Philosophie. Appliquée à la dissertation philosophique, la méthode dialectique a pour premier intérêt d’éviter les deux écueils que sont l’unilatéralité et l’éclectisme. Mais elle a en outre pour caractère propre de faire de la réfutation l’élément essentiel de la preuve philosophique. Par là même, elle donne le moyen de l’engagement sur une thèse, évitant de réduire la philosophie à quelque chose d’aussi vague que “ l’esprit critique ”, ou à un interminable commentaire de commentaire de textes. – On notera, peut-être à regret, la présence de quelques redondances : proximité entre certains sujets, récurrence de certaines sources, que leur importance rend décisives pour le traitement de nombreuses questions, sous des angles d’attaque divers. La philosophie critique notamment semblera particulièrement sollicitée. Rien d’étonnant à cela dès lors que l’on a de la dissertation la conception ci-devant définie. La philosophie critique n’est pas mobilisée ici comme celle qui permettrait de résoudre par un acte de jugement (en grec : krisis) les contradictions qu’elle met en évidence, mais plutôt comme un moment de crise où un philosophe installe sa pensée dans des contradictions d’où elle ne réussit pas vraiment à sortir, non plus que les doctrines qui se sont par la suite inspirées de ses positions fondamentales. Le profit dialectique de la philosophie critique est, de ce fait même, qu’elle dessine assez précisément les positions auxquelles il convient de renoncer si l’on veut résoudre les problèmes qu’elle pose. – Après une hésitation entre une mise en ordre logique des thèmes traités et un ordre de difficulté croissante, on a choisi de présenter les leçons suivant l’ordre alphabétique. Le livre étant destiné avant tout au travail, on n’a pas craint de maintenir l’indication en note de la référence des textes cités ou utilisés. Qu’on y voie une provocation à la lecture, en vue d’une réflexion plus approfondie sur des contenus dont la présentation ici ne peut éviter le raccourci. – Les textes étrangers cités en note ont, sauf exception, fait l’objet d’une traduction originale, ou de la révision personnelle de traductions existantes.
Leçons (titres et introductions)
Qu'est-ce qu’une pensée libre ?
« On appelle esprit libre celui qui pense autrement qu’on ne s’y attend de sa part en raison de son origine, de son milieu, de son état et de sa fonction, ou en raison des opinions régnantes de son temps. Il est l’exception, les esprits asservis sont la règle… – Au demeurant, il n’entre pas dans la définition de l’esprit libre d’avoir des vues plus justes, mais bien plutôt de s’être affranchi des traditions, que ce soit avec bonheur ou avec insuccès. Mais d’ordinaire, il aura tout de même la vérité de son côté, ou tout du moins l’esprit de recherche de la vérité : il veut, lui, des raisons, les autres des croyances ». Dans ce § 225 d’Humain, trop humain, Nietzsche fait écho à la définition traditionnelle du « libre penseur », autrement dénommé « esprit fort » ou « libertin » : la liberté de la pensée est ici définie comme son affranchissement vis-à-vis de tout contenu imposé de l’extérieur, notamment de tout principe moral ou de tout dogme religieux donné à croire par la seule force d’une tradition. La pensée est dite libre si elle est capable de ne pas se conformer à ce que Marx dénomme « l’idéologie dominante ». Déjà Nietzsche jugeait que ceux qu’il pouvait considérer comme des esprits libres étaient « très rares », un happy few, une élite composée d’exceptions, qu’il opposait au « troupeau », devenu majoritaire, des héritiers démocrates de ceux qui furent libres penseurs au Grand Siècle et au Siècle des Lumières. Mais depuis, les idées nietzschéennes concernant la libération de la pensée ou des mœurs se sont largement répandues au point que les libres penseurs sont devenus les nouveaux bien-pensants, et que le non-conformisme a changé de camp. Il paraît dès lors difficile de définir la liberté de la pensée par le seul affranchissement vis-à-vis de ce qui est traditionnellement ou communément admis : la pensée ne serait libre qu’à la condition de revenir périodiquement à ce qu’elle aurait antérieurement renié, de même que la mode féminine feint de se renouveler en s’allongeant et en se raccourcissant tour à tour. Sous cet aspect, la libre pensée apparaît comme une définition formelle et vide de la liberté de la pensée. Est-il alors possible de définir une liberté qui sauve la pensée de l’asservissement tout en échappant à cette contradiction ?
Avoir raison
Au rebours d’une longue tradition issue de la définition grecque de l’homme comme zoon logon échon – animal ayant raison –, Heidegger écrit, à la fin de son commentaire du « mot de Nietzsche : Dieu est mort », dans ses Holzwege : « La pensée ne commence pour la première fois que si nous avons éprouvé que la raison glorifiée depuis des siècles est l’ennemie la plus acharnée de la pensée ». Cette thèse assurément, de la part de quelqu’un qui passe pour philosophe, ne peut paraître que paradoxale, parce qu’elle remet en question la définition que la philosophie a constamment revendiquée et répandue d’elle-même depuis son origine. Héraclite par exemple se donnait pour tâche de « penser » plutôt que de simplement « savoir » (Fgt 40 DK), et demandait pour cela qu’on « écoute non pas (lui), mais le logos » (Fgt 50 DK). La thèse de Heidegger est à cet égard une profession d’irrationalisme qui entend dépasser, sinon la philosophie, du moins la forme qu’elle s’est donnée dans « l’histoire de la métaphysique », censément close avec Nietzsche. Il est toutefois difficile d’évaluer la portée exacte de la thèse. L’irrationalisme se présente en effet ici comme une préférence donnée à la pensée contre la raison. On ne saurait toutefois lui demander quelle raison il y a de préférer la pensée : voir dans l’opposition de la raison à la pensée une raison de renoncer à la raison, c’est donner raison à la raison tout en lui donnant tort. L’irrationalisme ne peut dès lors être cohérent qu’à la condition de se présenter comme un parti pris, dont on ne voit pas en quoi il pourrait invalider le parti pris opposé, qui consiste, depuis Socrate, et sans doute même un peu avant, à admettre qu’il ne suffit pas de croire ou d’affirmer quelque chose pour avoir raison de le faire. La question est donc de savoir si la prétention à avoir raison peut être autre chose qu’un parti pris, sinon même un voile jeté sur la violence de toutes les prises de parti possibles.
La propriété
La Déclaration universelle des Droits de l'Homme met la propriété au nombre des droits fondamentaux imprescriptibles de la personne humaine. Cela peut paraître paradoxal du fait que la pensée moderne a développé une critique parfois virulente de la propriété privée. Rousseau déjà, dans son Discours sur l'Origine et les Fondements de l'Inégalité parmi les Hommes, la dénonce comme une « adroite usurpation » dont son bénéficiaire a réussi à faire « un droit irrévocable » (2ème partie, § 33). Au siècle suivant, Proudhon publie sa proposition célèbre : « La propriété, c'est le vol ». Cette formule est toutefois elle-même paradoxale. Car d'un côté, la propriété ne paraît condamnable que si on peut dénoncer en elle une appropriation arbitraire ou injuste, ce qui est la définition même du vol. D'un autre côté, le vol se définit comme atteinte à la propriété, et si la propriété est elle-même un vol, cela implique que le vol soit une atteinte à lui-même, ce qui revient à dire qu'il n'est pas du tout une atteinte à quoi que ce soit. La formule de Proudhon semble bien être une justification du vol, mais elle implique du même coup que la propriété est une appropriation qui n'est ni plus ni moins légitime que celle qui est censée lui être contraire. Ainsi la dénonciation de la propriété contient sa justification et la thèse de Proudhon paraît devoir être complétée : si la propriété est un vol, elle n'est pas un vol. Peut-on dès lors, plus sérieusement, donner à la propriété un sens qui échappe à cette contradiction ?
La tolérance
À quelqu'un qui lui reprochait son intolérance, Paul Claudel répondit : « La tolérance, monsieur, il y a des maisons pour ça ! ». Claudel était un catholique converti à la suite d'une expérience mystique à Notre-Dame de Paris. Sa répartie est évidemment la mise en cause d'une revendication devenue essentielle depuis le siècle dit des Lumières, en politique comme en philosophie, celle qui définit la tolérance comme vertu exigible de tout citoyen d'un État républicain. La parole de Claudel exprime donc ce qui a fait dénoncer le catholicisme comme forme d'intolérance incompatible avec les exigences d'une république laïque, c’est-à-dire constituée indépendamment de toute confession religieuse et permettant par là-même aux diverses confessions de coexister pacifiquement. Mais ce mot fait apparaître en même temps le paradoxe d'une tolérance qui ne peut éviter de dénoncer comme intolérable ce qui la met en cause, et paraît du même coup exclure ce qu'elle prétend tolérer. La question est donc de savoir si la tolérance peut vraiment être définie comme une vertu, exigible à la fois moralement et politiquement, c’est-à-dire de savoir comment on peut être tolérant sans se contredire, puisque, selon un principe kantien célèbre, n'oblige moralement que ce qui peut être universellement voulu sans contradiction.
Le simple
En 1962, Sempé intitulait son premier recueil de dessins : Rien n’est simple, expression courante d’une certaine lassitude désabusée devant les complications de l’existence, que l’humour du dessinateur transformait en autant d’occasions de sourire. Sans doute faut-il entendre dans ces mots, qui ne vont jamais sans une manière de soupir, l’aveu d’un regret que les choses n’aient pas la simplicité qu’on leur voudrait, comme si cette qualité était pour nous l’objet d’un secret et profond désir. De fait, lorsqu’elle est entendue en son sens moral, nous y voyons volontiers un idéal difficile, voire inaccessible, en tout cas rarement réalisé, et nous éprouvons spontanément quelque commisération à l’égard de ceux qui, comme l’on dit, se compliquent la vie, quelque irritation lorsqu’on nous le reproche, de l’impatience ou de l’indignation à l’égard de ceux qui, par malice ou faiblesse de caractère, créent des complications inutiles ou nuisibles dans les relations entre les personnes. L’aveu rend toutefois paradoxale et peut-être tragique la nostalgie qu’il exprime, car il la condamne manifestement au désespoir d’être guérie. Il est étrange que la simplicité soit à ce point désirée, si le nom de simple ne désigne rien qui puisse être. Et en effet, l’aphorisme cité a la simplicité lapidaire d’un énoncé métaphysique, qui porte sur l’être en général, et non pas sur quelque embarras de la vie quotidienne, comme s’il s’agissait pour celui qui l’énonce de trouver à son désappointement une justification ontologique sans appel. On pressent toutefois que, sous cette forme, la notion de simplicité ne peut avoir ni tout à fait le même sens, ni un sens totalement autre que celui qui la fait opposer aux difficultés quotidiennes. Le problème sera donc de savoir si l’on peut transposer métaphysiquement, donner une signification absolue, une portée universelle, à une constatation que nous imposent certains aspects de notre existence empirique.
Le temps a-t-il une autre réalité que celle de notre désir ?
Dans le traité des Passions de l’Âme (Art. 57 et 86), Descartes écrit que le désir ne se distingue pas de l’amour par son objet, car les deux passions ont rapport à un bien, ou du moins à quelque chose appréhendée comme telle. Si le premier diffère du second, c’est qu’il s’y introduit, dans le rapport à son objet, une référence au temps. Aimer, c’est reconnaître en l’éprouvant, à tort ou à raison, la bonté de quelque chose. Désirer, c’est viser un bien aimé qui n’est pas présent mais à venir. Thomas d’Aquin déjà spécifiait les deux passions en disant que l’amour a pour objet le bien comme tel, et le désir un bien virtuel (Somme de Théologie, Ia-IIae, q.20, a.1, et q.33, a.2). On peut se demander toutefois si le désir doit être défini en référence au temps, ou si ce n’est pas le temps au contraire qui doit être défini en référence au désir. Car un bien virtuel par définition n’est pas. D’un point de vue simplement logique, l’à-venir peut certes servir à spécifier le désir. Mais ce qui est réel ici, c’est le désir présent, comme le serait la joie que causerait un bien lui-même présent. Comment un non-être tel qu’un bien absent pourrait-il constituer une différence réelle ? C’est bien plutôt la différence éprouvée entre les passions de joie et de désir, sur fond d’amour, qui semble donner toute sa réalité à cette absence dans le présent, cette paradoxale présence de l’absent que nous appelons le futur. C’est ainsi que Leibniz, dans sa polémique antinewtonienne, définissait le temps, « ordre des successifs », comme une « idéalité » (Correspondance avec Clarke), soit comme un mode de représentation, dont toute la réalité consiste en ce que les substances conscientes que nous sommes sont, comme toute autre substance, animées de l’intérieur par une « appétition » (Monadologie, § 15), qui les fait tendre vers ce qu’elles ne sont pas déjà, mais avec cette particularité qu’elles ont l’aperception, c’est-à-dire la conscience de cette tendance. Que nous soyons réellement désirants n’est pas niable. Que nous ne le soyons qu’en imaginant un bien dont nous sommes présentement privés ne l’est pas non plus. La question est de savoir si le temps a une autre réalité que celle d’une structure imaginaire de notre désir, et si lui en prêter une ne relève de ces « illusions » que Pascal met au compte d’une incapacité, qui fait que « nous ne nous tenons jamais au temps présent », et que, « nous disposant toujours à être heureux, il est inévitable que nous ne le soyons jamais » (Pensées, L 47).
L'échange
Le terme d’échange est utilisé métaphoriquement au sujet des biens communicables, et au sens propre au sujet des biens partageables : il s’agit alors d’une forme d’acquisition. Si l’on compare celle-ci aux autres formes que sont la réception d’un don, ou encore le vol, ou la rapine, on jugera que sa différence spécifique paraît être l’égalité : celui qui échange est censé ne rien perdre dans l’échange, quoiqu’il se dessaisisse d’un bien, parce qu’il est censé y recevoir autant que ce qu’il cède. Cette égalité n’est pourtant pas facile à concevoir. Elle serait évidente si les choses échangées étaient identiques, mais alors l’échange serait dépourvu de sens. Il n’en a un au contraire que si celui qui échange y trouve un avantage, et s’enrichit d’un bien qu’il ne possédait pas. Mais s’il y gagne quelque chose, comment est-ce possible sans que l’autre y perde – ce qui rendrait l’échange encore plus absurde pour ce dernier ? La réponse est donnée par la notion d’équivalence, c’est-à-dire d’égalité de valeur entre les termes de l’échange. La première analyse philosophique de l’échange est celle d’Aristote dans le Livre V de l’Éthique à Nicomaque. Ce livre a pour objet la vertu de justice, dont Aristote dit qu’elle se définit communément soit, en un sens général, comme conformité à la loi (légalité), soit, plus particulièrement, comme une certaine égalité entre les membres d’une communauté. Il est amené par suite à chercher comment une telle égalité peut se trouver réalisée dans l’échange des biens, c’est-à-dire dans ce que nous appellerions le domaine économique. La question revient à se demander comment on peut déterminer l’équivalence des marchandises, autrement dit leur valeur.
Les sciences construisent-elles leurs objets ?
L’idée d’une construction de l’objet scientifique est devenue un lieu commun philosophique, depuis que Bachelard a exposé une épistémologie qui pourrait se résumer dans la maxime : « en toutes circonstances », dans la recherche scientifique, « l’immédiat doit céder le pas au construit » (La Philosophie du Non, p. 144). En opposition à une conception assez traditionnelle de la découverte scientifique, Bachelard affirme qu’un phénomène connu par la science est « non pas trouvé mais produit » (Les Intuitions atomistiques, p. 139), comme ces éléments qu’étudie le chimiste et qu’il ne rencontre jamais à l’état naturel : « cela suffit pour définir le réel en chimie comme une réalisation » (La Philosophie du Non, p. 53). Cette conception constructiviste de la science ne met pas seulement en question ce que Bachelard dénomme réalisme. Si une science ne connaît que ce qu’elle construit, il semble que ce qui existe indépendamment d’une telle construction – humaine – lui soit par définition inconnaissable. Cela s’appelle depuis les Grecs : la nature. L’idée bachelardienne paraît alors rendre inconcevable qu’il puisse y avoir une science ou des sciences de la nature, dont Bachelard entend précisément faire l’épistémologie. Peut-on en conséquence dire que l’homme ne connaît scientifiquement que ce qu’il construit, et en quel sens ?
N'y a-t-il de science que du mesurable ?
Un lieu commun de l’épistémologie contemporaine veut que la science moderne ait accompli des progrès dont la science antique s’était montrée incapable, grâce à l’application des mathématiques à l’expérience. Cette mathématisation supposait en effet la possibilité de mesurer les phénomènes, et la révolution scientifique ne put avoir lieu que moyennant l’invention d’instruments de mesure dont les Anciens ne disposaient pas, par exemple l’horloge au XIVème siècle. La possibilité de mesurer est apparue comme le moyen pour les sciences de la nature, et par la suite, de l’homme, d’acquérir la rigueur et l’exactitude qui depuis l’Antiquité faisaient des mathématiques le modèle de la science. C’est ainsi que selon Louis de Broglie, la physique n’est devenue « une science quantitative exacte qu’en s’appuyant constamment sur la mesure, c’est-à-dire en cherchant toujours à caractériser les aspects de la réalité à l’aide de nombres » (Physique et Microphysique, p. 88). Il y a cependant une difficulté à transformer ce fait historique en l’axiome selon lequel il ne pourrait y avoir de science que du mesurable, thèse volontiers admise par le scientisme moderne. La vérification de cette thèse n’a en effet jamais fait l’objet d’une mesure, et l’on ne voit pas comment elle pourrait le faire : car d’une part il faudrait pour cela considérer la cognoscibilité d’une chose en général comme une grandeur mesurable, et d’autre part, à supposer que cette bizarrerie soit possible, elle entraînerait le cercle vicieux de vouloir vérifier par la mesure la validité de la mesure elle-même. Ne pouvant faire l’objet du seul mode de vérification qu’elle reconnaisse, la thèse scientiste se condamne elle-même à n’être qu’une croyance ou, comme on dit, un dogme. Ainsi on ne pourrait savoir s’il n’y a de science que du mesurable, à moins qu’il n’existe un autre savoir que la science fondée sur la mesure, et un savoir au moins aussi certain qu’elle puisqu’il énoncerait à son sujet une vérité universelle et nécessaire. Faut-il donc se contenter de croire que la mesure est la condition fondamentale de la science, ou considérer que la thèse scientiste est une simple erreur à son sujet ?
Peut-on être libre sans l'être absolument ?
En quelque sens qu’on l’ait pris, et quel qu’ait été le jugement des philosophes sur la réalité de son objet, le terme de liberté a toujours connoté l’idée d’indépendance. Ainsi l’esclave n’était pas libre parce que sa conduite, et parfois sa vie, dépendaient de la volonté de son maître. Par la suite, la personne humaine fut déclarée libre pour autant que ses actions ne dépendraient que d’elle et de rien d’autre, et l’indépendance à l’égard du vouloir d’autrui fut toujours plus revendiquée comme valeur politique principale. Si l’on prend garde toutefois qu’indépendant signifie littéralement la même chose qu’absolu, on voit ce qu’a d’inévitablement problématique cette notion de liberté : appliquée à l’homme, elle paraît impliquer la contradiction d’attribuer l’indépendance à un être essentiellement dépendant et quant à son origine naturelle, et quant aux conditions naturelles et sociales de son action. Si la liberté humaine ne peut consister que dans l’obéissance aux lois de la nature et de la société, il semble qu’elle ne soit définie que contradictoirement par identification à son contraire, et ne soit donc en fait qu’une fiction idéologique. Comment dès lors peut-on être libre si l’on n’a pas l’indépendance absolue qui caractérise l’être absolu lui-même ?
Y a-t-il de vraies valeurs ?
Notre modernité paraît écartelée entre deux aspects de sa culture, qui la tirent en des sens contraires. D’un côté elle se flatte d’avoir fait des Droits de l’Homme l’objet de déclarations à la fois explicites et universelles, qui enracinent l’égalité de ces droits, la réciprocité de ces dus, dans une liberté essentielle possédée de naissance, c’est-à-dire dans une commune nature humaine, porteuse d’une commune vocation à l’humanité. L’humanisme des Droits de l’Homme suppose qu’il y a une essence de l’homme, une vérité de l’homme qui fait de chaque humain une personne respectable par les autres personnes et par les États, et qui fonde par là-même les valeurs morales. D’un autre côté, notre culture est marquée par l’apparition dans la philosophie d’une scission entre la vérité et la valeur. Nos sciences de la nature énoncent ce qui est, pour autant que cela est accessible à l’observation et à la mesure, mais elles se déclarent incapables de se prononcer sur ce qui doit être. Et comme elles sont réputées être, avec les mathématiques, les seules sciences, il apparaît impossible qu’il y ait une science des valeurs morales : celles-ci ne peuvent dès lors être objet que d’opinion ou, comme on dit, d’option. Il en résulte, par exemple, l’absurdité qu’il y a à demander à la médecine, pour résoudre les problèmes de bioéthique, des règles qu’elle ne peut plus fournir, et, plus généralement, l’impossibilité de savoir à quoi la science est bonne, si ce n’est à un développement technique ravageur, dans une société qui a, comme l'a dit Gustave Thibon dans un entretien télévisé avec Pierre Desgraupes, « pris pour fin la multiplication des moyens ». Telle est l’aporie. S’il n’y a pas de vraies valeurs, toutes les valeurs paraissent également arbitraires, et du coup assez peu valables, sinon pour une volonté qui n’a d’autre fondement qu’elle-même, ni d’appui que sa propre force. Mais comment penser une science des valeurs sans confondre ce qui doit être et ce qui est, comme si la déclaration des valeurs morales n’était pas rendue nécessaire par leur violation effective ?
Y a-t-il des vérités indiscutables ?
Depuis l’Antiquité, le scepticisme se définit par opposition à ce qu’il dénomme le dogmatisme, entendant par là non pas une école philosophique particulière, mais la prétention, commune à diverses écoles, de pouvoir énoncer des vérités certaines. Contre cette dernière les sceptiques invoquaient de nombreux arguments ou tropes, dont l’un des plus célèbres, le premier dans la liste dressée par Agrippa, fait état de la pluralité des écoles dogmatiques : celles-ci s’opposent et proposent comme certainement vraies des thèses qui se contredisent. La constatation du désaccord universel induit chez le sceptique un doute universel : si en effet il y avait une vérité dans les affirmations dogmatiques, elle ne donnerait pas lieu à un désaccord, et les écoles ne se combattraient pas. L’argument irait de soi s’il ne renfermait un présupposé, à savoir justement que la vérité devrait faire, comme on dit, « l’accord des esprits », selon une expression de Kant. Or le doute sceptique, étant universel, ne peut que s’étendre à cette supposition, car le scepticisme se supprimerait lui-même à la considérer comme évidente : ledit présupposé vient assurément du dogmatisme, mais comment le scepticisme pourra-t-il éviter d’être lui-même dogmatique s’il commence par prendre à son compte la conception dogmatique de la vérité ? Et s’il veut échapper à cette inconséquence, il semble que ses arguments disparaîtront avec la présupposition qui les inspire. Il faut donc mettre celle-ci en question, et demander si une vérité ne peut être reconnue comme certaine qu’à la condition de ne pouvoir être discutée.
Crime et châtiment
Les deux termes sont en général associés comme s’il y avait entre eux un rapport de consécution nécessaire. Mais la très grande variété, dans le temps et dans l’espace, des règles de la justice pénale, ainsi que la multitude des fonctions attribuées au châtiment semblent attester plutôt la contingence de ce rapport. Si donc l’on ne s’en tient pas aux faits, d’ordre juridique ou sociologique, on se demandera, philosophiquement, s’il y a dans la nature d’un crime de quoi justifier un châtiment, et tel châtiment.
Faut-il chercher un sens à l'histoire ?
La notion de sens de l’histoire a été fortement compromise en notre siècle par sa mise en œuvre politique, dans les États inspirés par le marxisme-léninisme : l’idéal d’une humanité réconciliée s’est trouvé transformé en motif d’oppression idéologique. D’un autre côté la débâcle des idéologies en notre fin de siècle expose les sociétés au désespoir nihiliste que Nietzsche, tout en le prophétisant, avait jugé insupportable : « n’importe quel sens plutôt que pas de sens du tout » (Généalogie de la Morale, 3ème dissertation, § 28).
Guerre et paix
La guerre est l’affrontement armé entre deux collectivités humaines dépassant en taille et en nature la famille ou le clan familial : tribus, cités, ou, plus généralement, États. Guerre et paix sont deux termes logiquement contraires, qui semblent comme tels exclusifs l’un de l’autre : un État est en paix tant qu’il n’est pas en guerre, et tant qu’il est en guerre, il n’est pas en paix. Cette tautologie insignifiante est non seulement, comme telle, sans intérêt, mais elle paraît mise en échec au regard d’une logique qui n’est plus seulement formelle, mais pratique. Aristote écrivait : « Personne ne choisit de faire la guerre en vue de faire la guerre, ni même de la préparer dans ce but ; on passerait en effet pour un vrai tueur si on prenait ses amis pour ennemis afin qu’il y ait combats et tueries » (Éthique à Nicomaque, Livre X, ch.7). Dans un contexte où il s’agit pour lui d’établir le caractère subordonné des vertus guerrières, Aristote rappelle que la guerre n’est pas une fin, mais un moyen d’avoir la paix. Ce moyen doit même être considéré comme nécessaire, si l’on en croit le célèbre dicton : Si pacem vis, para bellum, ce qui signifie littéralement que la volonté de la paix, loin d’exclure celle de la guerre, l’inclut. On peut pourtant se demander si un tel propos n’entre pas en contradiction avec la logique d’Aristote autant qu’avec sa philosophie morale. Celle-ci est en effet un finalisme éthique qui pose en principe qu’un moyen n’est bon que s’il est conforme à une fin bonne. La guerre étant le contraire de la paix, comment pourrait-elle en être le moyen adéquat ?
La justice tend-elle toujours à l'égalité ?
Au livre V de l’Éthique à Nicomaque (ch.6, 1131a 12), Aristote donne déjà comme un lieu commun, une évidence universellement partagée, ce que Marx prendra pour un « préjugé populaire » moderne (Le Capital, Livre I, lère partie, ch.l, 3) : « si l’injuste est l’inégal, le juste est l’égal, tout le monde le croit, et sans démonstration ». Ladite croyance trouve à s’exprimer symboliquement dans l’allégorie de la balance. Ce qui peut faire douter de la validité de cette formule si simple, c’est assurément d’abord la masse et la complexité des commentaires et des distinguos dont Aristote a cru nécessaire de l’entourer pour en expliquer le sens et le bien-fondé, mais plus immédiatement le fait que la justice ne va pas pour nous sans une institution – la Justice – qui implique une relation essentiellement hiérarchique, donc inégalitaire, entre le juge et ceux sur lesquels il exerce un pouvoir qu’il a et qu’ils n’ont pas. Le problème posé n’est toutefois pas une simple question de fait, qui serait sociologique ou historique plutôt que philosophique. Malgré sa connotation temporelle et factuelle, toujours donne à penser que la question porte sur une conséquence impliquée dans l’essence de la justice, c’est-à-dire sur la possibilité de définir celle-ci de façon cohérente comme visant l’égalité, eu égard à ses conditions réelles, lesquelles sont avant tout pratiques.
Le pouvoir de l'imaginaire
« Le plus grand philosophe du monde, sur une planche plus large qu’il ne faut, s’il y a au-dessous un précipice, quoique sa raison le convainque de sa sûreté, son imagination prévaudra. Plusieurs n’en sauraient soutenir la pensée sans pâlir et suer » (Pascal, Pensées, B 82). Les textes de Pascal sur l’imagination, nonobstant d’autres aspects de sa pensée, sont à mettre au compte de la critique rationaliste de cette faculté, mise au nombre des « puissances trompeuses » : le pouvoir de l’imaginaire, fruit de l’imagination, est la hantise de la conscience rationnelle et la menace contre laquelle elle cherche à se prémunir pour ne pas en subir l’emprise. D’un autre côté, on reproche volontiers à quelqu'un – par exemple au rédacteur d’une copie – de « manquer d’imagination », dénonçant par là non pas un pouvoir mais plutôt un manque de pouvoir, une incapacité de l’imagination à produire son fruit : comme si la raison se trouvait cette fois en défaut, capable tout au plus de reproduire le même plutôt que de produire l’autre, le nouveau, le différent. Sans doute ne s’agit-il pas dans les deux cas du même pouvoir, l’équivoque tenant ici aux deux sens du génitif, subjectif et objectif. Sans doute est-ce aussi à penser cette équivoque comme ambiguïté de l’imagination elle-même, et de son fruit, que le sujet convie.
Qu'est-ce qu'un cynique ?
Le cynisme désigne dans notre langue une forme particulièrement odieuse de la méchanceté : telle l’attitude d’un criminel qui viendrait pavoiser devant l’innocent qu’on aurait condamné à sa place, ou celle de Dom Juan offrant au pauvre « pour l’amour de l’humanité » l’or qui n’a pas réussi à acheter son blasphème. Le terme cynique a pourtant servi d’abord à désigner une école philosophique dont les membres avaient une réputation de grande vertu, et faisaient l’admiration non seulement des foules mais tout aussi bien des souverains : tel Diogène aux yeux d’Alexandre. Comment expliquer cette dérive sémantique ?
