- Accueil
- Philosophie
- Recensions
- Recensions MNL
- Vivre selon la raison
Vivre selon la raison
Jean Cachia, Vivre selon la raison – Saint-Léger éditions, septembre 2015, 326 p.
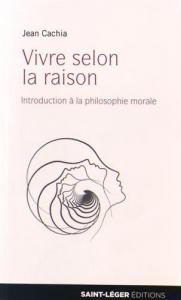
C’est ici l’œuvre non pas de toute une vie, encore et toujours féconde, mais de toute une carrière, qui n’a pris fin que récemment.
Cette Introduction à la philosophie morale (sous-titre du livre) est en effet le fruit et la synthèse de près de quarante ans d’enseignement de la philosophie, auprès d’innombrables élèves de terminale ou de classes préparatoires aux grandes écoles. L’auteur peut se prévaloir d’une solide et profonde formation philosophique, auprès de maîtres qu’il cite (Michel Gourinat, Claude Tresmontant), laquelle l’a fait accéder à l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm, puis au concours d’agrégation. L’acquisition de plus d’une langue étrangère, hébreu compris, lui permet de lire dans le texte la plupart des philosophes qu’il cite, de Platon à Heidegger, en passant par Augustin, Thomas et Kant. Ces références sont donc toujours de première main.
Tous ces acquis auraient pu avoir pour résultat le seul étalage d’une érudition écrasante. L’intérêt et l’originalité du livre résident plutôt dans le fait qu’il déploie le contenu d’un véritable enseignement, peaufiné à l’usage d’élèves débutants ou déjà initiés, lesquels ne manquent jamais d’imposer des exigences d’intelligibilité dont profitent l’enseignant autant que l’enseigné. La clarté pédagogique n’est pas le moindre mérite de l’ouvrage, lequel s’est en outre forgé à l’école d’une pratique dialectique de la philosophie. Cet héritage de la sagesse antique et médiévale est sans doute ce qu’il reste de meilleur dans notre enseignement philosophique scolaire et universitaire. Il comporte le grand avantage d’éviter toute forme de didactisme historiciste autant que de dogmatisme : il s’agit à tout moment de chercher réponse à des problèmes, et non pas de s’enquérir de l’opinion des philosophes auxquels on se réfère, moyennant néanmoins une compréhension en profondeur de leur pensée, et, à tout le moins, une attention très rigoureuse à l’exact contenu de leurs textes.
Le projet de l’auteur était manifestement de faire porter à un enseignement scolaire de la philosophie tout le fruit dont il est capable, à l’extérieur autant qu’à l’intérieur de la classe. Il renoue ainsi avec l’antique conception de la sagesse, soit de la philosophie en tant que genre de vie, manière d’exister, au-dedans comme au-dehors, pour le plus grand profit – disons d’entrée de jeu : pour le bonheur – de la personne et, par rebond, de tous ceux avec qui elle entre en relation, volontairement ou non.
Tel est l’objet du premier chapitre, qui mobilise et articule les deux aspects de la raison mentionnée par le titre : l’appel à celle-ci n’a ici de sens que parce que la raison est capable du vrai, et d’une vérité qui ne se limite pas aux acquisitions réputées scientifiques auxquelles le scientisme contemporain voudrait la confiner. Autant dire que l’ouvrage s’engage d’emblée – le premier terme de la première phrase est le nom de Kant – dans une controverse avec les doctrines qui, tant dans l’Antiquité qu’aux Temps modernes, tendent à creuser un abîme entre la vérité théoriquement accessible et les principes susceptibles de régler la conduite humaine d’une manière conforme à la raison. La conception de la sagesse morale ici exposée et défendue reconnaît à la raison une capacité, solidement étayée par ailleurs [voir, du même, Le Créateur de l’univers, Paris, F.X. de Guibert, 2006, 235 p.], de connaissance métaphysique, sans laquelle la philosophie ne se distinguerait des autres disciplines théoriques que comme une sorte de littérature s’arrogeant fallacieusement le caractère de science. Il y a tout lieu de chercher à vivre selon la vérité – soit selon une connaissance vraie du bien – dès lors qu’il y a une vérité accessible à la raison humaine par-delà ses acquisitions dans le domaine des mathématiques, ou des sciences de la nature.
C’est en effet seulement d’une telle vérité que l’on peut attendre une réponse à la question du sens de la vie, objet du deuxième chapitre. L’auteur s’y confronte à l’opposition entre l’être et la valeur, héritage kantien qui reste prégnant dans les formes contemporaines de l’existentialisme, et dans toutes les pensées selon lesquelles le domaine axiologique n’est pas celui d’une vérité connaissable. Ce dernier devient dès lors l’empire d’un volontarisme radical, et les efforts de Kant pour donner à celui-ci l’allure d’un rationalisme pratique n’ont pu empêcher, et ont plutôt favorisé, à un siècle de distance, la dérive nihiliste du volontarisme moderne. Preuve par l’absurde que la destitution de la métaphysique théorique par la philosophie critique a été, contrairement aux intentions de Kant, tout sauf l’unique moyen de sauver la morale contre ses mises en question matérialiste et athée. Seule la connaissance métaphysique permet de savoir que le souverain bien de l’homme, toujours visé sous le nom de bonheur, réside avant tout, comme Platon l’enseignait, dans le bien subsistant qu’est l’absolu divin. Faute d’une telle référence en pratique comme en théorie, la conduite de la vie morale, personnelle et collective, cherche désespérément à se suspendre dans le vide.
Un mérite insigne du livre est à cet égard de ne pas en rester à la discussion métaphysique, inévitablement fort abstraite, des principes d’ordre ontologique qui constituent un horizon de pensée permettant d’espérer une réponse aux questions morales fondamentales et décisives, ou, comme nous disons, « existentielles ». Bien plutôt s’enfonce-t-il dès le chapitre III dans ce qui, conformément à la leçon d’Aristote, est beaucoup plus important d’un point de vue moral que la connaissance formelle des préceptes, ou celle des fondements métaphysiques qui leur donnent sens. Ce chapitre porte en effet sur la « formation de la personnalité » (p.79), soit sur ce qui est susceptible d’ordonner en pratique l’existence de chacun à la vérité reconnue qui lui apporte son sens ultime. Qu’on ne se méprenne pas : il ne s’agit pas ici de « psychologie » au sens moderne du terme dans le classement des disciplines. Il s’agit de cette connaissance philosophique de l’âme humaine qui s’est déployée, depuis l’Éthique à Nicomaque, dans une doctrine des vertus reposant sur l’affirmation, expérience à l’appui, que la personne humaine est « principe de ses actions », et à cet égard « cause de soi », moyennant cette capacité que la tradition philosophique, depuis le Stoïcisme, a dénommée libre arbitre. La confrontation avec Kant et ses héritiers fait donc place ici à une discussion du spinozisme, dont on sait qu’il a professé une dénégation du libre arbitre à l’homme comme à Dieu, position à laquelle beaucoup aujourd’hui s’accrochent qui ne manquent pas par ailleurs de revendiquer haut et fort des libertés de choix publiquement reconnues : si je veux, quand je veux… On vérifie ici encore que la connaissance métaphysique de la liberté humaine – et non seulement sa postulation à la manière kantienne – est ce qui donne à l’humanisme moral une cohérence qu’il perd lorsqu’il prétend s’adosser à une ontologie ou une « science » qui l’ignorent.
La doctrine des vertus, d’inspiration profondément aristotélicienne, a en outre l’intérêt de montrer, à l’encontre de dichotomies caractéristiques de notre modernité, comment chacun peut acquérir la conscience d’être l’artisan de son propre bonheur. La vertu n’est pas ce qui rend la vie difficile et déplaisante, mais au contraire, une fois surmontée la difficulté qu’il y a effectivement à l’acquérir, ce qui rend la vie plus facile et plus plaisante.
La teneur propre du chapitre III explique pourquoi c’est seulement ensuite qu’est prise en considération la notion à laquelle souvent la problématique de la philosophie morale se trouve fâcheusement réduite. Quel sens y aurait-il en effet à réfléchir sur la « conscience morale » si le seul fondement qui donne un sens à cette notion – la liberté – était réputé inexistant (Spinoza) ou inconnaissable (Kant) ? Le chapitre IV n’en traite pas moins d’une question qui reste fort prégnante dans la réflexion contemporaine, au point d’avoir suscité il n’y a pas si longtemps une encyclique papale. Il s’agit en effet du rôle de la conscience – du jugement sur ce qui est à faire, soit sur une action à considérer comme bonne – dans la détermination du caractère moral d’une conduite. Ce qui est mis ici en discussion, c’est « l’infaillibilité de la conscience » (p.124), telle que la revendiquent les formes contemporaines du subjectivisme permissif, lequel comporte le paradoxe d’en appeler à la conscience pour valider en dernière instance la conduite, tout en la rendant incapable de fonder la moindre obligation : celle-ci ne peut différer d’une exigence arbitraire qu’à la condition d’être fondée sur la connaissance d’un bien objectif, laquelle peut assurément donner lieu à erreur. L’auteur est ainsi amené à discuter la conception rousseauiste de l’infaillibilité de la conscience – « instinct divin » – et à rouvrir le débat sur le caractère obligatoire de la « conscience erronée » (p.143). Appel est fait ici, pour traiter de ce point, aux références majeures que sont Aristote, Thomas d’Aquin, Pascal et Hegel.
On pourrait s’étonner de n’aborder qu’au chapitre V la notion qui paraît pourtant présupposée dès le départ, comme l’alpha et l’oméga de la réflexion morale. On pourrait voir hâtivement une faiblesse de l’ouvrage dans le fait que l’ordre de ses chapitres ou la logique de cet ordre ne paraissent pas immédiatement intelligibles. On peut aussi juger que, s’il y a là un sujet d’étonnement, ce n’est pas forcément au détriment de la quête philosophique de la vérité, puisqu’il est reconnu et souligné depuis Platon que celui-là est le père de celle-ci. L’étonnement est le point de départ de la dialectique parce qu’il n’est rien d’autre que le sens du problème. Ici, c’est la nature dialectique du propos qui permet de saisir le sens de son ordre, fût-ce après-coup.
C’est en effet le contenu du chapitre consacré à l’essence de la personne qui permet de comprendre sa place dans l’ensemble. Nul ne contestera que cette notion soit la pierre d’angle de toute réflexion en matière de morale et de droit, en politique comme en éthique, la première étant ici valablement conçue comme déploiement et mise en œuvre de la seconde. Les droits humains que la modernité se flatte d’avoir déclarés n’ont de sens qu’à être fondés sur la dignité inaliénable que les personnes humaines tiennent de leur commune appartenance à l’espèce humaine, soit à une communauté de nature qui est une vérité de fait et n’est à la discrétion de personne. Pour autant, le chapitre V entreprend la défense d’une conception réaliste et objectiviste – il faut même dire : substantialiste – de la personne, à l’encontre des tentatives modernes pour définir celle-ci en référence à la seule conscience, envisagée soit au sens général de la subjectivité pensante (Descartes), soit au sens de la conscience morale (Kant). On voit que cette mise en discussion de certaines formes contemporaines de l’humanisme personnaliste supposait les acquis des chapitres précédents quant à la réalité du libre arbitre et à la conscience morale. Mais on saluera aussi la désinvolture - au meilleur sens (italien) du terme - dont l’auteur fait preuve, d’une manière on ne peut mieux argumentée, à l’égard des diverses formes du subjectivisme et de l’idéalisme modernes, et d’auteurs trop souvent invoqués comme des statues du Commandeur dont on ne saurait contester l’autorité.
La conquête dialectique d’une définition cohérente de la personne et de sa dignité morale conduit, tout naturellement cette fois, à l’étude des relations interpersonnelles, qui sont l’objet même de la moralité, mis à part ce qui concerne le développement de la personnalité. La transition est donnée par deux paragraphes fort représentatifs de la volonté comme de l’art de l’auteur de ne pas en rester aux abstractions ontologiques ou axiologiques : « ‘‘La personne est un bien à l’égard duquel seul l’amour constitue l’attitude appropriée et valable’’. Karol Wojty?a réinterprète ainsi l’impératif catégorique de Kant sous la forme du commandement de l’amour. En tant que la personne est capable de choisir le bien, on doit reconnaître cette richesse en voulant son bien, c’est-à-dire en l’aimant. Mais l’amour porte sur la personne et non sur l’espèce. De même que la personne, sujet de droits et de devoirs, est un être individuel concret, une substance, et non un universel, de même la personne à qui le respect, l’amour est dû, n’est pas l’humanité mais l’individu humain. [§] Ce commandement définit en général l’amour du prochain comme le résumé de la moralité, mais il explique aussi dans une acception plus particulière du mot ‘‘amour’’ tout le sens de la chasteté : d’un point de vue psychologique, celle-ci se présente en effet comme la fixation du désir sexuel sur un individu. La chasteté consiste donc dans la règle qui veut que le désir sexuel porte sur la personne aimée et non sur l’animal de l’autre sexe spécifiquement pris. Ce point de vue sera développé dans le prochain chapitre » (p.170-171).
On comprend alors que le chapitre consacré aux relations interpersonnelles porte moins sur l’obligation et le devoir que sur l’« amour » et l’« amitié » (p.173). On retrouve ici ce qui fut la fraîcheur de l’Éthique à Nicomaque, et de ce qui en est resté, Thoma mediante, chez les grands spirituels tels que François de Sales, assez loin des aridités du formalisme et du rigorisme kantiens. La dialectique philosophique apparaît comme le moyen savoureux d’attester que le mariage est la véritable forme de « l’amour libre » (p.184), et comment Thomas d’Aquin a trouvé chez Aristote les ingrédients permettant de penser la charité comme « amitié avec Dieu » (p.207).
Non moins intéressant paraîtra le chapitre suivant, consacré à la politique et à ses relations avec la morale : examen dialectique de ce qu’il reste convenu d’appeler le « réalisme » d’inspiration machiavélienne, examen qui conduit à reconnaître dans les diverses formes du totalitarisme l’aboutissement sinistre d’une prétention à affranchir la politique de la morale. Le marxisme-léninisme est longuement discuté (p.227-235), tout autant que la conception classique du pouvoir absolu (p.217-223). Appuyé sur le personnalisme de Jacques Maritain dans Humanisme intégral, l’auteur analyse la prégnance de la gnose dans la pensée et l’action politiques modernes (p.237-249).
Un intérêt particulier de ce chapitre tient à l’audace de l’auteur à faire descendre la philosophie morale dans l’arène de la géopolitique, en toute conscience des risques de l’entreprise, eu égard à l’incertitude qu’un aristotélicien ne manque jamais d’avouer dès lors qu’il s’agit de juger dans l’ordre des singularités historiques, et non plus dans celui des universels conceptuels. Ces pages (249-253) présentent pourtant une belle acuité, nourrie d’une connaissance puisée à bonnes sources de l’histoire contemporaine.
Quant au dernier chapitre (VIII), il est lui aussi de nature à convaincre qu’une dialectique philosophique ancrée dans les auteurs les plus classiques est encore à même d’apporter des éléments d’analyse et de réponse aux questions qui sont les nôtres. On ne saurait en fait reprocher à l’auteur de ne guère citer, tout comme son maître Gourinat, les auteurs contemporains, car il en cite au besoin d’encore vivants, même s’il ne fait pas grand place à des auteurs à la mode, l’intempestivité étant après tout, comme Nietzsche le reconnaissait si longtemps après Platon, un caractère inamissible du philosophe digne de ce nom.
Le livre n’a pas non plus pour but d’entrer dans le détail technique des débats qui ont agité la théologie morale des derniers siècles, sur le tutiorisme et le probabiliorisme par exemple, mais de donner à qui le lira les moyens philosophiques d’acquérir, intellectuellement autant que pratiquement, sa propre sagesse, et d’avoir une vie sensée même si le monde refuse de l’être.
Son dernier chapitre porte sur la religion, donc plus précisément sur la place de la religion dans la morale et dans la politique, à partir de la question de savoir si « toute religion implique (…) une révélation » (p.257). Cicéron, comme Aristote, classait la religion parmi les vertus morales, conception que beaucoup aujourd’hui considèrent comme surannée. Pourtant, la recherche d’une juste conception de ce que nous appelons laïcité de l’État ne peut être conduite sérieusement en faisant bon marché de la distinction classique entre religion naturelle et religion révélée – le fond du problème étant là encore la question de la connaissance métaphysique rationnelle de la divinité. Qu’il puisse exister quelque chose comme une « obligation de croire » (p.298) en fera bondir plus d’un, mais on n’en trouvera pas moins d’intérêt à découvrir que toute religion ne suppose pas une révélation, et qu’au contraire « la révélation suppose la religion » (p.294).
Comme d’habitude, je m’abstiens d’égrener un petit catalogue de réserves plus propres à attester la pénétration du recenseur que l’intérêt de ce qu’il recense, faute duquel il n’y aurait pas travaillé. Je n’ai pas non plus prétendu résumer l’ouvrage pour dispenser de le lire, mais voulu bien plutôt inviter à cette lecture, comme un Guide vert dit qu’un lieu « vaut le voyage » ou, à tout le moins, « le détour ». La dernière proposition citée le suggère : ce livre a entre autres l’intérêt de bousculer, comme il sied à la philosophie, pas mal d’idées reçues. L’intérêt aussi de produire une philosophie qui, si scolaires soient les moyens qu’elle se donne, n’est pas une philosophie d’école, mais une réelle quête de sagesse, dont plus d’un étudiant a reconnu avoir tiré bénéfice, bien au-delà de la seule réussite universitaire.
Michel Nodé-Langlois
Publié dans le Bulletin de Littérature Ecclésiastique de l'Institut Catholique de Toulouse.
